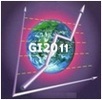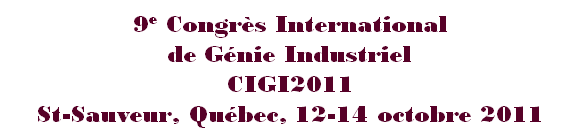CIGI2011
St-Sauveur, Québec, 11 — 14 octobre 2011

MC4 Industrie du bois
12 oct. 2011 14h00 – 15h40
Salle: St Moritz
Présidée par Sophie Bernard
4 présentations
-
 14h00 - 14h25
14h00 - 14h25Marquage du bois dans la masse : Intérêts et perspectives
Cet article présente les premiers travaux relatifs à un nouveau paradigme de « matière communicante ». Dans celui-ci, la matière envisagée est le matériau bois que l’on souhaite marquer dans la masse. A partir de cette hypothèse,nous étudions la pertinence d’un tel marquage sur la chaîne logistique du bois. Ainsi, nous abordons l’intérêt de conserver et d’utiliser les informations rattachées au matériau afin d’aider au pilotage de la chaîne logistique. Les échanges d’informations sont modélisés afin de faire apparaitre les informations importantes et la façon dont elles peuvent être utilisées. Enfin nous montrons la nécessité de fusionner ces informations de marquage avec celles issues de différents types de capteurs pour que la traçabilité soit totale tout au long du cycle de vie. Afin de nous aider dans l’étude de cette pertinence, nous proposons un démonstrateur pour simuler cette matière marquée dans la masse.
-
 14h25 - 14h50
14h25 - 14h50Quelques enjeux soulevés par l'analyse de cycle de vie d’un produit du bois en contexte québécois
Les entreprises manufacturières doivent aujourd’hui répondre à de nouveaux impératifs
environnementaux. À cet égard, elles cherchent à mieux défini r l ’impact de l’ensemble de leurs
activités et lorsque cela est possible, à mettre en valeur leur performance environnementale. Dans
certains secteurs, où la compétition est particulièrement vive, la capacité de présenter une offre
compétitive à plus faible impact environnemental peut permettre à l ’entreprise d’augmenter
considérablement ses parts de marchés. C’est dans cet esprit que ce travail vise, d’une part, à étudier
le cas d’un producteur de bois lamellé-collé, à quantifier son empreinte environnementale en réalisant
une analyse de cycle de vie et à identifier des pistes d’amélioration possibles de la chaîne de valeur de
l’entreprise sur la base de ses impacts mesurés. Les résultats mettent en lumière les enjeux soulevés
par les analyses de cycle de vie issues de données primaires spécifiques au contexte québécois par
comparaison avec celles européennes et américaines. Dans le cas du produit du bois à l’étude, les
émissions de gaz à effet de serre sont de l’ordre de la moitié de celles estimées dans les bases de
données disponibles. -
 14h50 - 15h15
14h50 - 15h15Intégration de la simulation et de l’optimisation pour la planification tactique forêt-usines
Ces travaux concernent la planification tactique dans l’industrie des produits forestiers. L’objectif consiste à prendre simultanément les décisions concernant la récolte (choix des blocs de coupe et modes de récolte), l’allocation des bois aux usines et la transformation des bois en usine. Nous proposons un système de planification intégré où un module d’optimisation (LogiOpt) est connecté à un simulateur des opérations de récolte (FPInterface) et à un simulateur des opérations de sciage en usine (Optitek).
-
 15h15 - 15h40
15h15 - 15h40Approche de pilotage pour un complexe de sciage agile
Ce document propose une première étape de conception d’une approche d’agilité appliquée à l’industrie forestière et plus particulièrement aux usines de sciage de bois d’oeuvre. On commence par une exploration du contexte et de l’environnement d’affaires pour en ressortir des besoins industriels et une problématique de recherche. Ensuite, l’agilité est spécifiée sur la base de trois cadres : conceptuel, contextuel et expérimental. Dans les deux premières dimensions, la modélisation d’affaires a été combinée avec le contexte de l’industrie forestière pour cadrer l’agilité en tant que vision et définir les attributs de mise en oeuvre, de mesure et d’amélioration dans un environnement volatile. La performance a été introduite en tant que structure intégrant la dimension d’affaires et les spécificités industrielles. Le cadre expérimental vient ensuite s’inscrire dans la spécification de l’approche d’agilité pour permettre de valider les liens entre les différents composants et le contexte étudié. Une première génération d’expérimentations a été explorée, et d’autres sont prévues pour les travaux futurs. En conclusion, nous avons envisagé l’introduction d’un cadre décisionnel qui permet d’enrichir le concept et le contexte par le développement d’aptitudes de pilotage d’agilité et des actions qui la promeuvent.